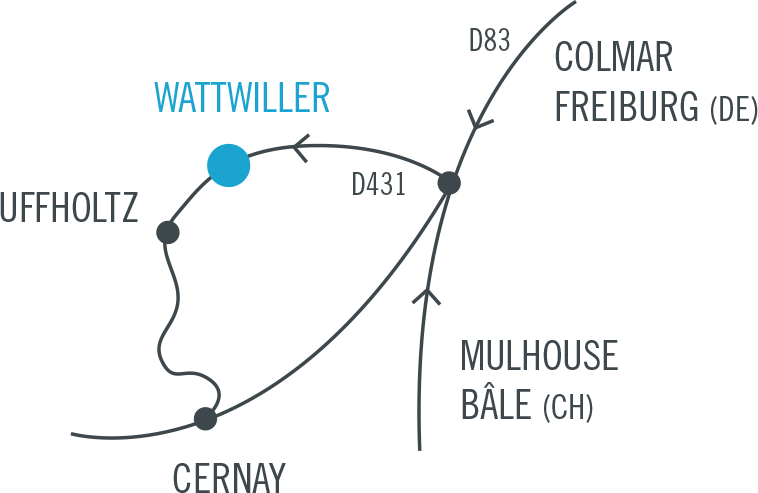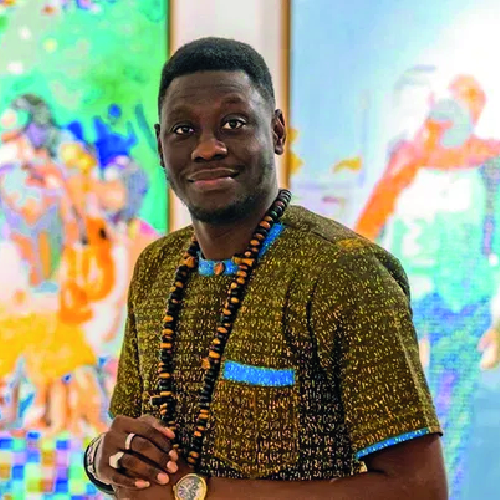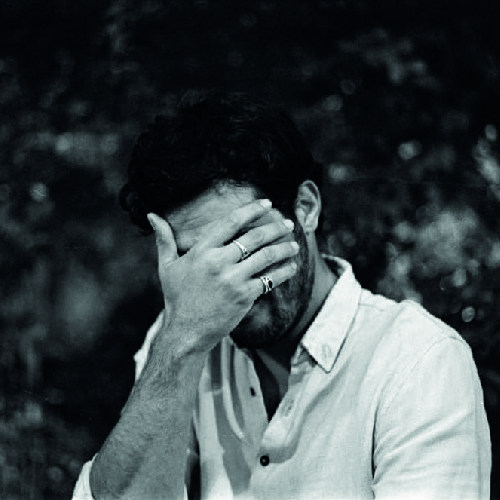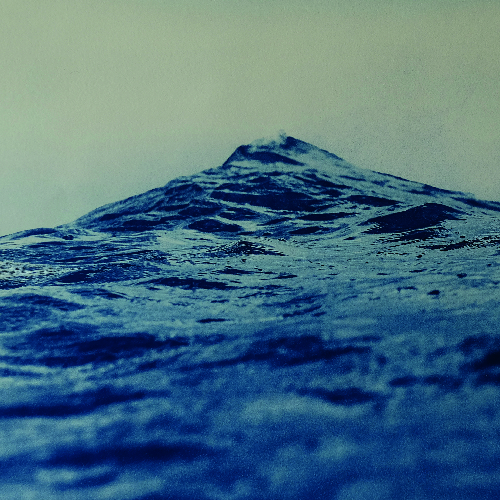Talents contemporains 14e édition
Quatre comités d’experts ont sélectionné en février dernier les œuvres ou projets de 32 finalistes parmi les 621 candidats originaires de 75 pays.
Le grand jury 2024, placé sous la présidence de Jean-Noël Jeanneney, était composé de :
Rosa-Maria Malet – Directrice de la Fondation Joan Miró 1980 – 2017, membre du Conseil d’administration de la Fondation (Barcelone)
Constance de Monbrison – Responsable des collections Insulinde, musée du quai Branly – Jacques Chirac (Paris)
Alfred Pacquement – Conservateur général honoraire du patrimoine (Paris)
Chiara Parisi – Directrice du Centre Pompidou-Metz (Metz)
Ernest Pignon-Ernest – Artiste (Paris)
Roland Wetzel – Directeur du Musée Tinguely – (Bâle)
Les artistes révélés pour cette 14e édition sont Julie Bourges, Ladislas Combeuil, Alioune Diagne, Eléonore Geissler, Paul Heintz, Mehrali Razaghmanesh et Enrique Ramírez.
Nous félicitons chaleureusement les artistes et nous nous réjouissons d’accueillir prochainement leurs œuvres dans la collection.